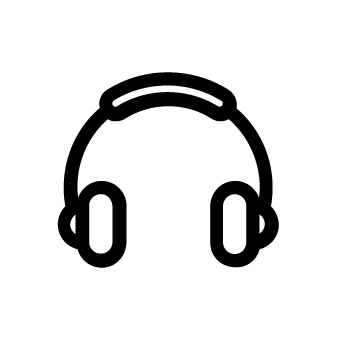Accueil / Portraits de jazzmen / Portrait de Cecil Taylor
Cecil Taylor (1933-2018)
Depuis toujours, nous les musiciens Noirs, nous considérons le piano comme un instrument de percussion, nous battons le clavier et nous pénétrons l’instrument. La force physique entre dans le processus de la musique noire. Qui ne l’a pas compris n’aura plus qu’à hurler
. Cecil Taylor (cité par John Litweiler dans The Freedom Principle : Jazz After, 1958)
Un « new-yorker »
Aucun musicien n’exprime plus puissamment tout ce que résument ces deux syllabes : New York. Ses premiers héros sont d’ailleurs presque tous des New-Yorkais, de naissance ou d’adoption : Fats Waller, Duke Ellington, Thelonious Monk, Bud Powell, Lennie Tristano, mais aussi Stravinski et John Cage. Cecil Percival Taylor, né en 1933, a grandi à Corona. C’est à l’époque l’un des rares quartiers « mixtes », plutôt cossu mais à majorité noire, celui où s’installe notamment Louis Armstrong. Bien qu’il ne manque jamais de revendiquer son appartenance à la communauté noire, ses origines familiales sont exceptionnellement complexes : du côté paternel, il a un bisaïeul écossais et deux autres amérindiens ; sa grand-mère maternelle est également amérindienne. Sa passion pour les chants et les tambours des « Native Americans » est d’ailleurs omniprésente dans sa musique, et il a fortement conscience d’être l’héritier à la fois des victimes du génocide et de celles de l’esclavage. « Free » est donc pour lui infiniment plus qu’un mot banal et galvaudé, ou qu’une étiquette étincelante collée à sa musique par la critique, qu’il traite avec une ironie déstabilisante. Même pour un journaliste très expérimenté, croyez-moi, interviewer Cecil Taylor, c’est l’épreuve du feu, éclairante et fascinante, mais parfois douloureuse voire carrément horripilante !
Sa formation est tout aussi diverse. Dès l’âge de cinq ans, on lui donne des leçons de piano classique, puis il apprend la percussion avec un voisin timbalier du NBC Symphony Orchestra, alors dirigé par Toscanini. Un oncle l’emmène aux concerts des big bands de Jimmie Lunceford, qui l’enthousiasme, et de Cab Calloway, dont il tente d’imiter le « scat ». Il apprend aussi la danse, et accompagne des danseurs à claquettes. Bien des années plus tard encore, rares sont ses concerts où il n’improvise pas – comme le faisait Monk – une stupéfiante chorégraphie autour du piano. Il est d’ailleurs exceptionnel que Taylor soit vraiment « assis » devant un piano. Il donne l’étrange impression quand il joue d’être à la fois debout et presque à genou, dressé et comme prêt à bondir (à tel point qu’on ne sait plus, de lui ou du piano, qui est le fauve ou le dompteur), mais aussi ployé dans une sorte de révérence quasi-mystique devant l’instrument.
Un jusqu’au-boutiste du piano
Les innombrables détracteurs de Cecil Taylor – aucun pianiste de jazz n’a essuyé autant de sarcasmes – le perçoivent comme un iconoclaste du clavier, un terroriste des touches, un massacreur de feutres. Il n’est pas si loin le temps où, dans certains festivals, la terreur des assureurs et des loueurs était telle qu’en son honneur, et en catimini, on substituait au « bon » piano un instrument fatigué, prêt à être revendu à un conservatoire désargenté. Or, il est peu de pianistes qui témoignent d’un amour et d’un respect aussi passionnels du piano, et dont la musique soit aussi profondément « pianistique », utilisant jusqu’à l’extrême limite les ressources de l’instrument, et d’autant plus sensible à ses moindres imperfections. Cecil Taylor est simplement le premier pianiste à avoir oublié que le piano est un meuble. Et de même que le plus rude hiver new-yorkais ne l’a jamais dissuadé de faire son jogging quotidien, il travaille son piano quatre ou cinq heures par jour – nombre de pianistes « de jazz », considérés comme plus « sérieux », seraient bien en peine d’en dire autant !
Pour qui a bien écouté l’un et l’autre, la filiation entre Duke Ellington et Cecil Taylor est si transparente qu’elle semble défier l’analyse : autrement dit, un beau sujet de thèse ! Les compositions ellingtoniennes sont omniprésentes en tant que telles dans ses premiers albums, et sous forme de citations plus ou moins cryptées dans la plupart de ses concerts. Plus que de filiation, mieux vaut parler d’une allégeance absolue, sans doute unique dans l’histoire du jazz. L’approche percussive du clavier (qui ne signifie nullement la moindre renonciation à l’harmonie ou à la mélodie) constituait déjà un enjeu majeur pour le Duke dès le début des années 1930. Elle fut une révélation pour le jeune Cecil Taylor, frais émoulu du New England Conservatory et jusqu’alors plutôt attiré par les recherches harmoniques de trois pianistes « blancs » : Dave Brubeck, Dick Twardzik et surtout Lennie Tristano. De ce dernier, qui fut son seul véritable « professeur d’improvisation », il a reconnu l’influence comme une soudaine illumination : Un jour, je jouais devant lui les accords de base de « You Go to My Head », essayant de dégager un contre-chant du pouce de ma main gauche. Il m’avait demandé de m’inspirer de la version de Billie Holiday. À un certain point, mon contre-chant ne marchait plus avec la mélodie à la main droite, et Lennie me l’a fait aussitôt remarquer. « Ouais, je sais ! », ai-je admis. Il m’a dit simplement : « Tu ne le sais que dans ta tête, je m’en fous de ce qui se passe sous ta tignasse. » Ce que j’ai compris à ce moment précis, c’est qu’il y a bien d’autres moyens de percevoir la musique : par exemple, avec les mains et les oreilles
.
La liberté et l’unité
Lennie Tristano est à juste titre considéré comme un grand précurseur du free jazz. Son élève en sera l’un des pionniers à la fin des années 1950, époque où (ce n'est sûrement pas un hasard) il est en pleine psychanalyse. Il va sans dire que les querelles de paternité n'ont guère de sens, s’agissant de ce qui est plutôt une explosion de fraternité qu'une expression solitaire. Cecil Taylor y trouve vite ses partenaires : il enregistre avec Steve Lacy, Coltrane, Archie Shepp, Jimmy Lyons, Sunny Murray, joue souvent avec Albert Ayler. Il rencontre aussi en 1958 le trompettiste Bill Dixon. Il adhèrera à sa coopérative – la « Jazz Composers Guild » – et enregistrera avec lui le formidable Unit Structure (1966). Il adopte définitivement ce terme, « Unit », pour désigner ses orchestres, éphémères et toujours changeants. Michel Portal se l’appropriera comme un hommage, quelques années plus tard. « Unit » veut dire unité au sens où on l’utilise à l’armée, à l’hôpital ou à l’usine. Mais le « taylorisme » n’a rien d’agressif ni de productiviste. Il est plutôt une forme de musicothérapie, au sens où Ayler disait que la musique est la force guérisseuse de l’univers
. Conception personnelle et ancestrale de la performance musicale, entre la possession à l’africaine et le chamanisme amérindien, qui deviendra l’éternelle obsession de Cecil Taylor.
Ce n’est pas la seule. Ce dandy à l’élocution si précieuse, dont la sobriété vestimentaire et l’ascèse physique ont toujours contrasté avec les tenues exotiques et les excès en tout genre de la plupart des jazzmen free, s’est toujours fait un point d’honneur d’écarter tout folklore inutile et tout baroque superflu de sa musique. Cecil Taylor est un musicien « nu », fragile et farouche quoique jamais désabusé. Il incarne cette force mystérieuse, fataliste et sauvage qui ne se manifeste plus guère en Occident que chez les derniers grands cantatores du flamenco. On se demande comment d’autres musiciens parviennent à pénétrer sans se brûler grièvement ce bloc de bois brut et incandescent qu’est le piano de Cecil Taylor. Pourtant, non seulement ils existent mais ils sont assez nombreux, peu connus en général, et forment autour de lui une famille très fidèle - pour ne pas dire un fan club ! L’Anglais Tony Oxley en fait partie depuis une quinzaine d’années. Comme la plupart de ses drummers antérieurs (Sunny Murray, Andrew Cyrille, Thurman Barker, etc.), il incarne en même temps le batteur que Taylor rêverait d’être dans une nouvelle vie, et le coloriste capable par un harcèlement de touches éclaboussantes d’enrichir encore la densité et l’intensité de son jeu. C’est en effet le vocabulaire des arts plastiques et non celui de la musique qui pourrait peut-être, s’il existait des mots à sa mesure, suggérer sinon décrire ce que reflète le piano de Cecil Taylor. Sombres espaces et nymphéas abyssaux, courbes voluptueuses éclatées en angles infiniment obtus, tourbillons masculins interrompus par des volutes féminines, dripping de noir sur un lac blanc, cascades de notes bleues dans un gouffre de sang. Mais qui a dit que la musique devrait être moins improvisée, moins « vécue » que la peinture ?
Cecil Taylor décède le 5 avril 2018.
Auteur : Gérald Arnaud
(extrait des notes de programme du concert du 25 octobre 2002 « Electric Body »)
 Imprimer
Imprimer