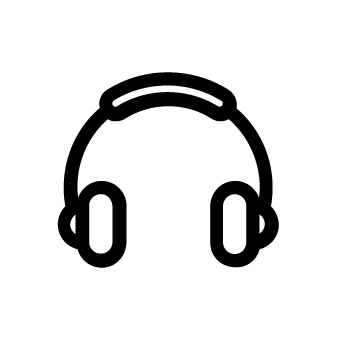Accueil / Portraits de jazzmen / Portrait d’Abdullah Ibrahim
Abdullah Ibrahim (1934-)

Si le terme de métissage peut s’étendre au champ musical et notamment au jazz, et s’il peut trouver sa signification dans une trajectoire individuelle, c’est sans nul doute dans celle d’Abdullah Ibrahim. Par son enracinement dans toutes les catégories de la musique populaire sud-africaine, qu’elle soit festive ou rituelle, par sa captation d’une tradition continue du jazz classique et moderne, il a développé une attention inlassable à l’entrecroisement du rythme et du timbre, de la mélodie et de l’harmonie. Pianiste percussif dans la lignée d’Ellington et de Monk, il s’est progressivement ouvert à la dimension orchestrale du sonore qu’il pétrit, telle une pâte, à la façon d’un plasticien. Abdullah Ibrahim reflète et incarne également le jazz – lieu d’échange et de dépassement par excellence d’une dialectique de la liberté et de la contrainte – par une conscience politique et sociale aiguisée par l’apartheid. À ce titre, il fut de ceux qui jouèrent à l’occasion de la cérémonie d’investiture de Nelson Mandela (1994).
Premiers albums
Né le 9 octobre 1934 au Cap (Afrique du Sud), de son vrai nom Adolphe Johannes Brand, Abdullah Ibrahim se fera appeler « Dollar » Brand au début de sa carrière et jusqu’à sa conversion à l’Islam en 1968. Son initiation au piano, à l’âge de sept ans, est sans doute encouragée par l’activité musicale de sa grand-mère, pianiste à l’église méthodiste locale. La ville portuaire dans laquelle il a grandi, véritable creuset du brassage culturel sud-africain, lui a offert un premier modèle. Sous l’influence du jazz découvert par les enregistrements, aisément accessibles via les nombreux marins transitant par Le Cap, il devient musicien professionnel au début des années 1950, enregistre en 1954 dans le big band swing des Tuxedo Slickers puis forme son propre trio quatre ans plus tard. En 1959 il est à la tête d’un sextet, les Jazz Epistles, qui comprend notamment le saxophoniste alto Kippie Moeketsi et le trompettiste Hugh Masekela. Deux albums considérés comme importants pour le jazz sud-africain sont enregistrés pour la compagnie Gallo/Continental (Johannesburg), dont Jazz Epistle : Verse I en 1960.
Exil européen
Les conditions faites alors par le régime aux populations noire et métisse, avivées par le massacre de Sharpeville (mars 1960), conduisent Dollar Brand, comme d’autres artistes sud-africains, à un exil européen où l’accompagne sa future femme, la chanteuse Sathima Bea Benjamin. Rejoint par ses partenaires, il reconstitue son trio à Zürich, se produit et enregistre à Paris, puis en Allemagne et au Danemark (Cafe Montmartre, Copenhague). L’occasion lui est donnée de rencontrer et de se faire entendre par Don Byas, Dexter Gordon, Ben Webster, John Coltrane ou Thelonious Monk. La rencontre pourtant décisive, celle de Duke Ellington à Zürich en 1963, conduira Brand (mais aussi Benjamin, admirée par Ellington) à enregistrer sur sa recommandation à Paris pour le label Reprise (Duke Ellington Presents the Dollar Brand Trio). Ainsi commence une carrière européenne puis américaine (Antibes, Londres, Newport…). Consécration suprême, Brand officiera comme pianiste de l’orchestre d’Ellington à l’occasion de quelques dates lors d’une tournée en 1966. La même année, il enregistre avec Elvin et Thad Jones aux côtés d’Hank Mobley. Sa palette s’enrichit alors de l’étude du violoncelle, auquel s’ajouteront bientôt divers instruments à vent ou percussion.
Multiplications des projets
Revenu en Europe en 1968, en pleine période free (collaborations avec Barbieri, Tchicai, Cherry…) puis en Afrique du Sud et au Swaziland (où il fonde la Marimba School of Music), Dollar Brand devient musulman et prend le nom d’Abdullah Ibrahim. Il tourne abondamment, en Europe à nouveau, aux côtés de Don Cherry, Carlos Ward, Johnny Dyani et Nana Vasconcelos, explore le solo, le duo, la grande formation, compose pour le Jazz Composer’s Orchestra... Particulièrement présent au Cap et à Johannesburg au milieu des années 1970 (avec le ténor Basil Coetzee), Ibrahim regagne New York. Ses activités et rencontrent se multiplient, du duo (Archie Shepp, Max Roach, Johnny Dyani, Randy Weston) à un orchestre de douze musiciens (le Ujamaah 21st Century Collective). Son Kalahari Liberation Opera sera donné en Europe en 1982 alors que son septet Ekaya connaîtra différentes moutures (comprenant notamment Carlos Ward, John Stubblefield, Howard Johnson, Cecil McBee…). Il faut encore évoquer la composition de bandes originales (Chocolat puis S’en fout la mort de Claire Denis en 1987 et 1990).
Au début des années 1990, Ibrahim se partage entre son pays natal délivré de l’apartheid et New York. Parmi ses nombreux projets, figure en 1998 l’exécution de ses pièces en Europe par un orchestre de vingt-deux cordes (arrangées par le compositeur suisse Daniel Schnyder), projet suivi d’une extension avec l’Orchestre philharmonique de la radio de Münich et le trio du pianiste (African Suite). En 1999 se déroule à Leipzig la première de Cape Town Traveler, un projet multimédia associant le groupe Ekaya, un ensemble vocal, des images filmées en Afrique du Sud et en Europe, ainsi que des sons électroniques. À la même période, Ibrahim est invité à donner conférences et concerts au Gresham College de Londres. Il fonde en 2004 l’école M7 dans sa ville du Cap : y sont enseignées sept disciplines considérées comme complémentaires parmi lesquelles la musique, la danse, les arts martiaux, la diététique ou la méditation.
L’héritage de Duke Ellington
Marqué à vie par sa rencontre et ses liens précoces avec Duke Ellington, Ibrahim fut l’un des tout premiers musiciens à lui rendre un hommage explicite (Ode to Duke Ellington, Inner City, 1973). Beaucoup d’autres le suivirent en cette voie mais son originalité reste d’avoir traité le matériau ellingtonien sous la forme d’une interpolation de compositions du Duke et d’originaux, alternance fonctionnant parfois à l’intérieur d’un même morceau (« Jump for Joy / Ode to Duke »). Son Autobiography de 1978, gravé en concert en Suisse, est un témoignage éloquent de la pluralité essentielle du geste musical (qui va au-delà d’un simple éclectisme stylistique) : la méditation, la danse, le chant ou la colère se succèdent et s’entrecroisent en parfaite cohérence. Difficile à observer globalement car pluridirectionnelle, oscillant avec générosité de la source folklorique et du marabi jusqu’au free jazz, la fusion d’Abdullah Ibrahim est de celles, rares, qui jamais ne versent dans la confusion.
Auteur : Vincent Cotro
(mise à jour : mars 2010)
 Imprimer
Imprimer